« Quelque diversité d’herbes qu’il y ait, tout s’enveloppe sous le nom de salade ». C’est avec cette plaisante remarque de Montaigne qui ouvre ainsi un court chapitre du Livre I des Essais, intitulé Des noms, que j’ai bien envie de commencer ma présentation de Gestion des espaces communs, livre de Dominique Quélen, paru il y a déjà quelque temps, aux éditions LansKine. Je ne sais si Michel de Montaigne que Dominique Quélen cite d’ailleurs également pour clore l’avant dernière partie de son ouvrage, se serait régalé à la lecture d’un ouvrage qui, sans quelque assaisonnement tiré du Tractatus de Wittgenstein, comme des efforts de la linguistique contemporaine, paraîtrait sans doute bien étrange à son ancien palais. La rare pénétration pourtant dont il fait montre à propos des relations entre le mot et la chose, en ferait pourtant un goûteur d’exception.
« Il y a le nom et la chose ; le nom c’est une voix qui remerque et signifie la chose ; le nom, ce n’est pas une partie de la chose ny de la substance, c’est une pièce estrangere joincte à la chose, et hors d’elle. » Il faudra garder à l’esprit cette utile et féconde remarque[i] pour accompagner la suite d’observations, d’investigations, portant sur ces espaces supposés communs, du monde et de la langue, qu’explore avec un sérieux drolatique, mais pas que, un Dominique Quélen qui, introduisant son ouvrage en le présentant comme « l’histoire naturelle d’un espace où les objets ne sont reliés entre eux que parce qu’il est clos», poursuit en s’inspirant d’une formulation de Perec dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien[ii] : « nous n’allons pas choisir ce qui restera quand nous aurons enlevé tout le reste, mais quand nous aurons même enlevé ce qui restera, tout en gardant incertaine jusqu’au bout la nature de ce que nous ferons en écrivant »
Une fois n’est pas coutume, je citerai entièrement la quatrième de couverture qui revient sur cette notion d’espace clos et insiste sur le caractère exploratoire, aventureux et quelque peu autotélique de l’entreprise. « Une fois ôté tout projet d’écrire, y déclare l’auteur, on peut commencer de la façon la plus simple, faire avancer un nous, l’inscrire dans un espace élémentaire issu de l’enfance ou de l’administration des eaux et forêts, qu’il traverse on ne sait trop dans quel sens car il y progresse peu. Les éléments sont prêts pour un récit, mais disjoints, parfois défectueux. C’est un assemblage non-linéaire. Si chaque paragraphe est une nouvelle tentative, le but n’en est pas clair, quoique sans cesse il soit question de définir ce dont il s’agit. Du reste, le nous peut céder la place à un je, un tu, qui ne sont pas davantage individués. Ils ne sont aussi bien qu’un effet de la grammaire. Pas de solution de continuité entre la langue et le réel (ou la fiction), non parce qu’ils s’équivaudraient mais parce que croyant être dans l’un on est dans l’autre : ça communique, comme si – hypothèse – l’objet de ce texte était le texte lui-même et l’objet qu’il constitue, qui dérive à l’intérieur d’un espace clos. »
Gestion des espaces communs apparaît là comme une drôle de machine, voire de machinerie, qui laissera sans doute pantois bien des lecteurs, surtout ceux qui n’auront pas appris à se détacher de l’illusion toujours bien tenace d’une forme d’équivalence ou d’une toute naturelle transitivité, entre le mot et la chose. Entre la langue qui énonce- salade - et le réel fuyant infiniment - les herbes - qui s’y voit désigné. Divisé en 5 chapitres, parties, tentatives, renvoyant par leur titre à de grandes réalités génériques : le temps, les objets, la forêt- l’eau – le champ, les voies de communication, et enfin le récit, le livre qui prend ainsi l’apparence d’une sorte de traité plus philosophique que proprement poétique, multiplie les énoncés à première vue sibyllins[iii] qui ne manqueront pas, à l’occasion, de rappeler la fameuse formule de Lichtenberg, du couteau sans lame auquel on aura retiré le manche : « Tout favorise ici la vue. Les observations se font par un système de fenêtres découpées dans le vide et qui y tiennent, comme suspendues, n’ayant ni cadre ni carreaux, de sorte que rien n’arrête le regard, un tel dispositif aidant plutôt à le diriger souplement, libre ensuite à chacun d’agencer ce qu’il y met. Les vitres et les châssis qu’on voit un peu plus loin proviennent de fenêtres qui devaient gêner la vue d’une manière ou d’une autre, au cas où quelqu’un ait regardé. »
Ainsi, déclinant toutes sortes de paradoxes sensés déstabiliser non seulement le lecteur naïf mais la plupart aussi des autres, plus expérimentés, l’ouvrage de Dominique Quélen, nous fait parcourir d’étranges chemins de pensée allant, non du réel inconnaissable aux communes réalités que d’ordinaire nous nous efforçons de lui substituer, mais à l’intérieur d’un espace particulièrement retors de phrases où communiquent, comme on le dit des vases, le signe proprement dit et la chose signifiée. De cette absence de solution de continuité comme il dit « entre la langue et le réel », de ces aller-retours incessants entre l’espace extérieur référentiel rappelé par la langue et l’espace du signe, retourné sur lui-même, sourdent toutes sortes de considérations, d’interrogations, certes toujours surprenantes mais d’une grande logique, sitôt qu’en sont compris par nous la gestion, l’inventif fonctionnement. Et la fondamentale intellectualité. Ainsi de ce passage : « Nous faisons en chemin un peu de grammaire mêlée d’un peu de logique. Si une chose que nous disons est comme un mets délectable, c’est signe qu’elle est la chose même et que nous pouvons manger jusqu’à la phrase où nous la disons. »
[i] Qu’on trouvera au chapitre intitulé De la Gloire, à l’intérieur du Livre II des Essais. C’est ce passage que reprend Quélen.
[ii] « Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste : ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. » Pérec.
[iii] Ils ne paraîtront d’ailleurs totalement sibyllins que si l’on essaie à tout prix d’y voir une herbe particulière, réelle au lieu de l’effet de salade qu’ils font si l’on consent à rester dans ce fameux espace clos de la langue. Mais l’auteur joue toutefois à merveille des « infiltrations » qu’il sait que les mots permettent entre ces deux espaces que je dirai « herbes » et « salade ».
[iv] « Une grammaire des formes et des structures circule entre nous sans que jamais on sache qui l’a entre les mains, qui la lui a donnée, à qui lui la donnera, à qui l’a donnée le précédent qui l’a eue entre les mains, de qui l’aura eue le suivant une fois que celui qui l’aura eue avant lui entre les mains la lui aura donnée » p. 48. Communs donc ces espaces dont traite ici Dominique Quélen. Du monde que nous partageons avec les autres comme avec les objets, au langage tel en tous cas qu’on aimerait qu’il soit. Je remarque à cette occasion à quel point la phrase de Quélen, son vocabulaire, ses structures, indépendamment de ses contenus de pensée, reste toujours étonnamment claire. D’une parfaite coulée. D’une paradoxale limpidité. Là peut-être aussi se trouve la source principale, esthétiquement, de ses effets.
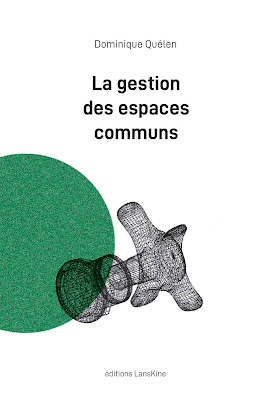
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire