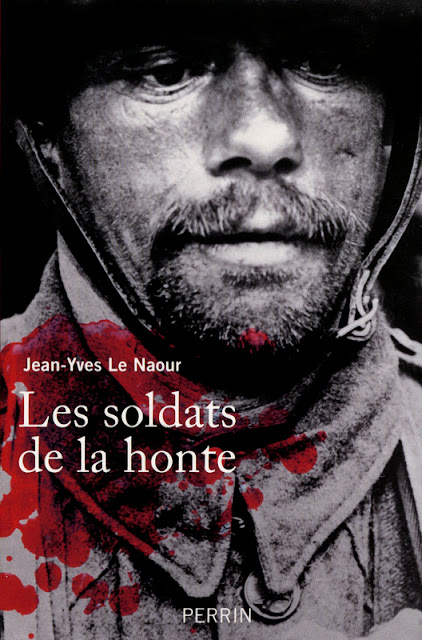Il vient de paraître dans le Journal Libération du 27 novembre 2017,
une Tribune signée par un collectif de personnalités civiles et politiques,
appelant à inventer « un lieu où se
croiseraient écrivains, artistes, enseignants, élèves et étudiants : une
maison pour réfléchir ensemble et pour transmettre la culture à tous ».
Si j’aurais personnellement préféré à la place du verbe
« transmettre » un terme plus ouvert permettant de comprendre que la
culture ne procède pas d’un capital figé qu’il s’agit d’abord de recevoir, mais
d’un effort permanent d’éveil et de co-naissance qui permet à chacun de trouver
en tout, matière à s’inventer soi-même et à comprendre davantage et les autres
et le monde, je ne peux, avec les Découvreurs, que regarder cette initiative avec
la plus grande sympathie.
Et c’est pour contribuer à cette réflexion que je crois aujourd’hui bon
de reprendre en partie le texte d’un billet publié en janvier 2014 pour protester
contre la façon dont, dans les programmes dits d’éducation artistique, sont
trop souvent oubliés, poètes et écrivains, au profit des artistes du corps et
de l’image.
Réduite à la simple vision,
l'image ne se partage pas. C'est pourquoi nous nous inquiétons de voir tant de
plans généreux, tendant de plus en plus à faire intervenir, en direction des
territoires, des artistes de tous ordres, continuer à faire l'impasse sur ces
formes essentielles d'art que sont la poésie et la littérature.
Les responsables
culturels ignorent très largement les artistes de l'écrit
Nous étant récemment intéressé à
la question des relations entre artistes et territoires nous avons pu réaliser
à quel point l'artiste était aujourd'hui sinon "instrumentalisé"
du moins fortement incité, par les diverses politiques actives dans ce champ, à
tenter de résoudre, par des moyens d'ailleurs de moins en moins propres à son
art, une partie des grandes questions se posant à nos sociétés : la question
par exemple de l'abandon ou du délaissement de certains territoires, celle de
l'absence, à une échelle plus large, de maillage entre les différentes parties
qui les constituent, pour finir par la grande et difficile affaire qui parfois
en découle, de la violence urbaine. Nous reviendrons peut-être un jour sur le
détail de ces questions.
Imaginer demander à l'artiste de
participer à ce que Jean-Christophe Bailly dans la Phrase urbaine,
définit comme "un travail de reprise" n'est pas en soi une
aberration. L'artiste par sa sensibilité, son intelligence ouverte capable de
coupler dans des démarches souvent plus intuitives que rationnellement
organisées, l'esprit d'invention qui découvre et la capacité de création qui
impose, peut aider à faire surgir des réels nouveaux. A redonner du sens.
Participer à de nouveaux modes de réconciliation entre les êtres. Entre les
choses. Entre les unes et les autres, aussi.
Nous ne pouvons toutefois nous
empêcher de remarquer que les appels d'offre proposés ainsi aux artistes, soit
dans le cadre des politiques d'éducation artistique et culturelle, soit dans
celui des politiques d'animation et de reconstruction des territoires qui
souvent d'ailleurs se recoupent, ignorent assez largement les artistes de
l'écrit. Au profit des artistes du spectacle. De ceux dont l'art n'est pas au
premier chef fondé sur la parole. Agit d'abord en affectant les corps. Et les
organes. Par le visible.