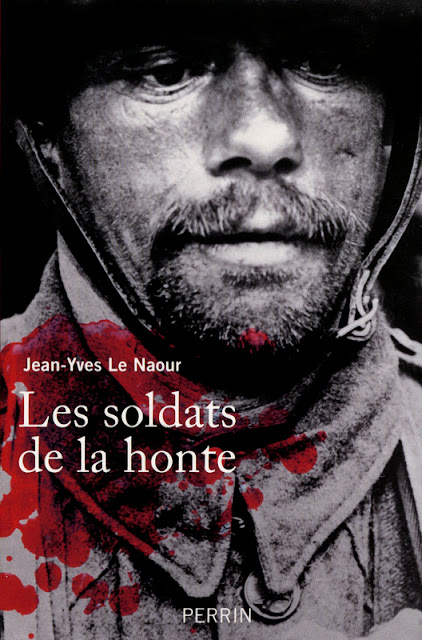Il est réconfortant après avoir enduré les intarissables
et nébuleux bla-bla de certains petits Narcisse institutionnels qui ne
condescendent à aborder les questions qui les dépassent qu'avec l'ironique ou
méprisant détachement qui fera d'eux toujours des goujats de la pensée, de
pouvoir compter, chez soi, sur l'amitié de certains livres. Et de retrouver, auprès
d'un auteur aimé, cet élan vital que le petit cirque culturel et ses
insupportables simulacres semblent en partie conçus pour briser. Le recueil de
nouvelles d'Alain Damasio, Aucun souvenir assez solide est de
ces livres qui, en dépit du tableau des plus manifestement inquiétant qu'ils
brossent de notre situation et de l'avenir que nous nous fabriquons, sont
susceptibles de nous redonner cette force, cette impulsion si nécessaires pour
ne pas renoncer à rester tout simplement vivants.
Il y aurait des pages et des pages à écrire pour rendre
un peu compte du caractère inventif et stimulant de l'œuvre de Damasio. Qui
mûrit ses livres sans être comme d'autres, obsédé par le rythme infernal des
publications. Ce qui donne à chaque fois des ouvrages qui nous travaillent
longtemps et dans les profondeurs. Je considère, pour sa puissance poétique,
bien supérieure à celle de trop nombreux ouvrages réalisés par de purs poètes
et pour la qualité des réflexions vers lesquelles il nous entraîne, sa Horde
du contrevent comme un des romans majeurs de ces dix dernières années
et attends avec impatience ses Furtifs qui devraient paraître
sous peu.*
Ne disposant pas aujourd'hui du temps, ni peut-être du
courage nécessaires pour revenir en détail sur toutes les impressions que m'a
laissées une telle œuvre, j'aimerais cependant quand même partager ici un court
passage d'une nouvelle dans laquelle la figure d'un scribe lancé tout entier
dans l'écriture impossible du Livre, celui qui fera corps enfin avec la vie,
rejoint pour moi idéalement la figure que je me fais depuis longtemps du
véritable lecteur, un lecteur pour qui la dictée du texte et la soumission à
laquelle ce dernier le contraint n'implique aucune perte de liberté,
constituant en fait l'occasion d'un déploiement qui n'a de limites que celles
qu'il se donne lui-même. Loin de tout fantasme de Vérité. D'identité. Délivré
de la tentation d'étouffer le lexique entraînant, rayonnant, de la vie, sa
brûlure, sous la cendre reposée des pensées d'inventaire.
TEXTE d’ALAIN DAMASIO
Il faut comprendre qu'El Levir défendait une vision de la
littérature (et plus encore du Livre, débat nodal) qui malgré la profondeur de
ses travaux et l'ampleur de l'estime que la communauté des érudits lui
accordait, non sans réticence, non sans crachat pour ses calligraphies de plein
air, n'était plus partagée par personne.
Cette vision, indiscutable pour lui, antérieure même à toute
raison, était que la littérature, comme tout art authentique, ne pouvait être
que puissance de vie. Donc que le Livre, s'il existait, ne pouvait qu'incarner,
avec la plus féroce intensité, la vie — et plus profondément qu'incarner, mot
presque statique, la faire fulgurer, siffler, se découdre comme une peau, pour
libérer, par éclats — par écart et petit bond, salto, vague haute déferlée,
rouleau ou ressac — une coulée de sang pur, d'un rouge d'encre longue, que rien
ne pouvait faire sécher, ni vent ni temps, ni le soleil au zénith. Rien,
puisque le rythme capturé-relancé à chaque lecture, à chaque attaque de glotte
placée au premier mot du premier vers, redéfroissait la totalité de la surface
physique du son, lâchait au souffle toute la violence articulatoire des
phonèmes briquetés et découplait, sur la page, la masse d'abord compacte des
lettres aboutées, pour lui déplier à mesure, comme on offre à un enfant une
plage, l'espace où s'architecture l'épars.
On avait toujours objecté, à cette vision, à cette audition,
à ce cri, l'idée que le Livre ne pouvait, s'il était unique, contenir quelque
chose d'aussi peu rigoureux que la vie, d'aussi multiplement déformable et
fluant. Pour une lourde majorité d'érudits, le Livre ne pouvait dévoiler que la
Vérité. La Vérité était une. Il n'y avait donc qu'un Livre. Marmoréen. Porteur
d'une lumière implacable. Lire le Livre était donc accéder à la Vérité de
l'Être, de la Nature ou du Monde (c'était selon la nature des digestions),
autrement dit à Dieu.
L'originalité d'El Levir, à ce titre, n'était pas tant qu'il
ne croyait à aucun dieu mais que n'y croyant pas, il n'eût pas renoncé à
l'espoir du Livre, comme si la Vie, le soleil ivre tournoyant dans le texte
suprême, pouvait jeter, du cœur de l'inscrit, en pleine âme, une couleur
unique. À la vérité, ses plus proches collaborateurs, dont je fus, surent
toujours qu'il n'en était pas exactement (pas du tout) ainsi. La théorie d'El
Levir, par ses ennemis simplifiée à outrance, s'appuyait sur cette
conviction : qu'un texte unique, même court, recelait une potentialité
vertigineuse de sens; que les effets de rythme, dans le plan d'immanence
sonore, pouvaient se démultiplier presque à l'infini, aussi bien par vibration
moléculaire, de proche en proche, que par effet sonar, avec des sons pulsés
dans le vide, sans écho audible, qui apportaient une respiration à même le
bruissement; enfin que le jeu des lettres et des mots, la proximité des
signifiants (par exemple, rappelait-il toujours, cette manière qu'a «nuit»
d'être hantée par son propre verbe, ou « lourd » de vibrer avec lent
et sourd), les anagrammes ou les palindromes (une passion dévorante du scribe)
pouvaient, si l'on en tenait compte «comme de spectres circulant dans l'ombre
blanche de la page», ouvrir au Livre la diversité du vivant. Un Livre unique,
oui, d'une seule couleur, pourquoi pas ? – disons bleu – mais d’un bleu
hurleur, changeant comme un ciel rougit, se violace puis vire soudain au noir.
Un Livre bleu polychrome.
Aucun souvenir assez
solide P. 236 - 238
* Ce billet a été publié pour la première fois le 14 avril 2014