« Depuis la péninsule du Labrador jusqu’à l’Alaska, la grande forêt boréale étale un manteau continu de conifères où prédomine la silhouette typique de l’épinette noire, à peine interrompu de loin en loin par quelques bosquets d’aulnes, de saules, de bouleaux à papier ou de peupliers baumiers. Les animaux sont à peine plus variés : élans et caribous pour les herbivores, castors, lièvres, porcs-épics et rats musqués pour les rongeurs, loups, ours bruns, lynx et carcajous pour les carnivores forment le gros contingent des mammifères ; à quoi s’ajoutent une vingtaine d’espèces communes d’oiseaux et une dizaine de poissons, ces derniers faisant bien pâle figure auprès des trois mille espèces qu’abritent les fleuves d’Amazonie. […] Les caractéristiques de la forêt boréale sont exactement inverses de celles de la forêt amazonienne : peu d’espèces coexistent dans cet écosystème « spécialisé », représentées chacune par un grand nombre d’individus. Et pourtant, en dépit de l’homogénéité ostensible de leur milieu écologique — en dépit aussi de leur impuissance face aux famines qu’engendrait régulièrement un climat d’une extrême rigueur —, les peuples subarctiques ne paraissent pas considérer leur environnement comme un domaine de réalité nettement démarqué des principes et des valeurs régissant la vie sociale. Dans le Grand Nord comme en Amérique du Sud, la nature ne s’oppose pas à la culture, mais elle la prolonge et l’enrichit dans un cosmos où tout s’ordonne aux mesures de l’humanité »[1].
Oui. De plus en plus je me demande si je ne vais pas au Musée pour approfondir toujours davantage ce large puits d’ignorance que les discours contraires du temps voudraient me donner l’illusion par là de combler. Ainsi, avant de mettre le pied dans les salles d’exposition consacrées aux Mondes arctiques, de l’Alaska au Nunavut, que le magnifique Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, nous propose désormais de découvrir, avais-je vraiment conscience de ne rien savoir de ces terres lointaines, de tous ces peuples dits premiers qui les habitèrent et continuent vaille que vaille d’y survivre.



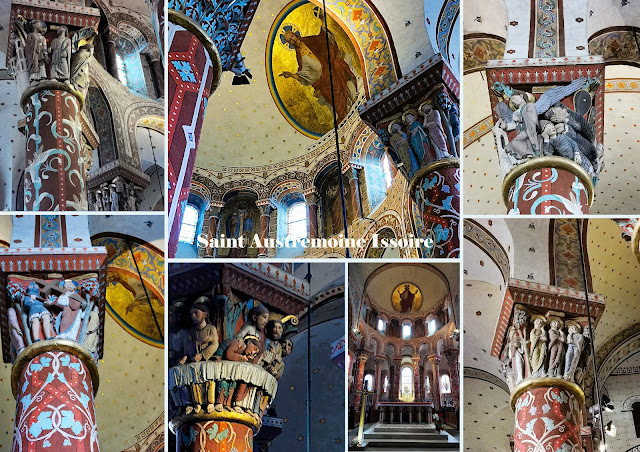


.jpg)


